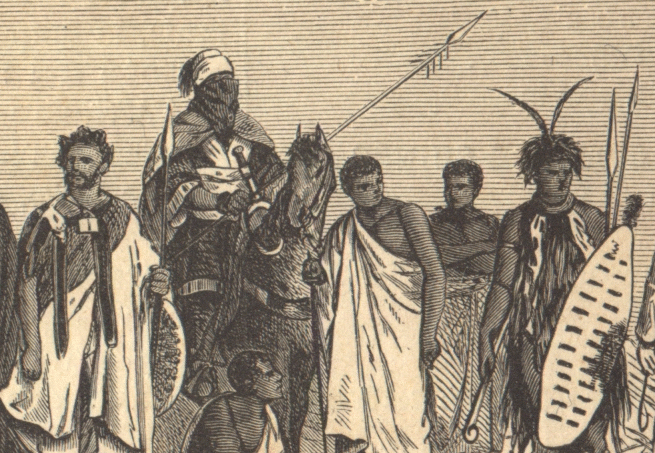
Quelques guerriers dans l’histoire

1
- Le fantassin de ligne de l’Empire
2 - Le fantassin de l’air 1936 – 1940
![]()
Le fantassin de ligne de l’Empire
« L’empereur
gagne ses batailles avec nos jambes »
Litanie des Grognards de l’Empire
« Ils
grognent mais marchent toujours »
Napoléon
Lorsque sont évoqués les soldats du premier
Empire, l’image du grenadier de la garde et de son bonnet à poils, dont le
souvenir est entretenu par les célèbres mémoires du capitaine Coignet, s’impose
naturellement. Les splendides hussards de Lassale ou les lourds cuirassiers
chargeant derrière Ney ou le prince Murat complètent le tableau de nos
imaginaires collectifs.
Mais force est de constater que le grand
oublié de l’armée impériale reste souvent son principal acteur. Le simple
fantassin de la ligne, paysan du Languedoc ou de Lorraine, Hollandais ou
Italien, a en effet formé les gros bataillons dont l’empereur disait depuis
Marengo qu’ils étaient seuls garanties de victoire.
L’infanterie de ligne, cœur de l’armée
impériale, reste distincte de l’infanterie légère jusqu’au milieu du XIXe
siècle. Elle en diffère toutefois fort peu, si ce n’est dans l’absence de
plumet au shako et surtout dans la composition des compagnies d’élite de chaque
bataillon et leur emploi au feu.
L’infanterie légère combat sur deux rangs et fait un plus large usage
des tirailleurs.
L’organisation de l’infanterie est sous
l’Empire largement héritée de l’Ancien Régime. L’ « Ordonnance portant
règlement sur les manœuvres » à la base de l’emploi de l’infanterie
date des années 1780 et est inspirée de Guibert et de l’école prussienne de
Frédéric II. Légèrement modifiée en 1791, elle fut par la suite simplifiée afin
de conserver et d’améliorer l’avantage des changements rapides de formation
tout en évitant la rigidité prussienne bien peu adaptée aux armées héritées de
la Révolution.
Le principe général de combat de
l’infanterie de Ligne est l’emploi simultané de tous les moyens de feu
disponibles : « Occuper un front qui permette l’utilisation de
toutes les armes; Multiplier les tirailleurs, passer rapidement de l’ordre
déployé à la colonne d’attaque ou au carré et réciproquement. »
Le bataillon de ligne comprend 10 compagnies
de 40 à 100 soldats dont 8 de fusiliers, une de grenadiers et une de
voltigeurs. La manœuvre de ces unités de base permet le passage rapide d’une
formation à une autre en fonction des nécessités du moment. Si l’ordre mince,
privilégiant le feu, est le standard européen, l’ordre profond, « en
colonne de divisions » ou en « colonnes serrées »,
meurtrier pour l’assaillant mais privilégiant la capacité de choc est typique
des armées de la Révolution. Napoléon adopte en Italie un « ordre
mixte » profitant des avantages des deux formations.
Les compagnies de ligne, couvertes par un
rideau de tirailleurs profitant des accidents du terrain, se déployant pour ce
faire « en bataille » sur trois rangs (deux à partir de 1813.)
Le premier rang à genou et le second, debout, tirant « à volonté »
pendant que le troisième recharge les fusils pour soutenir une cadence de tir
bien faible à l’époque (deux coups par minute, exceptionnellement trois, en
fonction de l’entraînement.) L’arme de
dotation est en effet durant toute la période le fusil à silex modèle 1777,
modifié en 1800 et 1803 mais restant en service jusqu’en 1840. Il se charge en
12 temps et 18 mouvements.
Si la discipline et la tenue au feu sont les
premières qualités demandées au fantassin, son endurance et sa capacité à
effectuer d’épuisantes marches forcées sont au cœur même de la
« manière » napoléonienne. Parcourant par jour jusqu’à 40 kilomètres
et plus à travers toute l’Europe avec un barda de plus de 30 kilos, les soldats
de l’empire permettent d’appliquer le principe de dispersion-concentration des
forces autorisant à Napoléon ses plus brillantes manœuvres (celle d’Ulm en
1805, conduisant à la reddition sans combat des 70000 hommes de Mack en étant
le plus bel exemple.)
C’est pourquoi la conscription de l’époque
élimine automatiquement (jusqu’à ce que l’urgence à partir de 1813 ne modère ce
principe), outre les hommes mariés, non seulement les hommes de trop petite
taille mais aussi les édentés qui ne peuvent déchirer les cartouches ou les
hommes incapables de parcourir les distances requises pour cause de déficiences
ou d’infirmités physiques. Le nombre de mutilés volontaires augmentera
d’ailleurs à mesure du rejet de la conscription, les réfractaires se trouvant
de plus en plus nombreux à partir de 1808-1809.
Les conditions de vie du fantassin en
campagne sont difficiles, le ravitaillement souvent aléatoire et les services
sanitaires dramatiquement insuffisants. Malgré l’usage de fours à pain mobiles
à la suite des colonnes et l’achat de
vivres sur place, la maraude est fréquente. Les soldats de l’époque meurent
trois à quatre fois plus souvent de maladie que par le fait du feu ennemi.
Figures les plus ordinaires des troupes
napoléoniennes, ces fantassins payèrent pourtant le plus lourd tribut des
guerres de l’Empire.
CARACTERISTIQUES
DU FUSIL A PIERRE MODELE 1777
Longueur :
1,52 m hors baïonnette (56 cm) Poids : 4,6 kg. Calibre : 17,5 mm
tirant une balle de 27 grammes.
Portée :
maximale de 970m, utile de 235m, efficace de 135m.
Opérations
de chargement :
1-
Chargez (2 mouvements)
2-
Ouvrez le bassinet
3-
Prenez la cartouche
4-
Déchirez la cartouche
5-
Amorcez
6-
Fermez le bassinet
7-
Arme à gauche (2 mouvements)
8-
Cartouche dans le canon
9-
Tirez la baguette (2mouvements)
10- Bourrez
11- Remettez la baguette (2 mouvements)
12- Portez arme
Conseils de lecture :
-
Blond (G) : La grande
Armée, Robert Laffont, 1979.
-
Buquoy : Série des Guerres
napoléoniennes, FR-17 - Les troupes des régiments de ligne.
-
Funcken (L et F) :
L’uniforme et les armes des soldats du Premier Empire, 1973.
![]()
Les
fantassins de l’air français (1936 – 1940)
« L’infanterie
de l’air est née, a vécu et a été dissoute au milieu d’une regrettable
indifférence »
Commandant
Michel, patron des GIA, 24 août 1940
Après la
Première guerre mondiale, malgré quelques essais sans grand lendemain comme
ceux de Mitchell aux Etats-Unis, l’intérêt des puissances à développer des
formations de troupes parachutistes ne s’éveilla que très tardivement. Seule
véritable pionnière en la matière, l’Union soviétique s’y intéressa massivement
dès 1925, créant une brigade dès 1931 et disposant en 1937 de 100000
parachutistes brevetés.
En France particulièrement,
cette innovation militaire promise pourtant à un brillant avenir mit longtemps
à s’imposer. La naissance d’une armée de l’Air indépendante (1933) sous
l’impulsion du ministre Pierre Cot allait pourtant au milieu des années trente
permettre de lancer une série d’essais, lesquels, bien que modestes, marquèrent la naissance effective
du parachutisme militaire français.
En octobre 1936 est décidée la création pour avril 1937 de 2 Groupes d’Infanterie de l’Air devant être stationnés à Reims (GIA 601) et à Maison-Blanche en Algérie (GIA 602). Chaque groupe doit initialement comprendre, avec deux escadrilles de transport et des services, une seule compagnie parachutiste de 175 hommes, dénommée compagnie d’infanterie de l’air, à 4 sections dont une de soutien. En tout, les deux groupes doivent initialement comprendre 750 officiers et soldats et une trentaine d’appareils Potez 65.
Même ces modestes objectifs ne
peuvent être véritablement atteints et les deux GIA connaîtront au cours de
leur brève existence un déficit permanent d’effectif et de matériel. Partagé et
sceptique quant à l’emploi qui peut être fait de ces troupes, le commandement
n’accorde en effet que de très sporadiques crédits de dotation.
Durant la drôle de guerre
(septembre 39 – mai 40), les deux GIA sont stationnés dans la région d’Avignon
et l’on s’interroge toujours sur leur utilisation tandis que les Allemands
s’apprêtent à faire la preuve des réelles potentialités de cette arme nouvelle.
Les fantassins de l’air n’auront d’ailleurs pas la possibilité de prouver leur
valeur par le moindre saut de guerre. Durant les terribles journées de mai et
juin 1940, une compagnie assurera la sécurité du général Vuillemin, commandant
en chef de l’armée de l’air tandis qu’une autre sera utilisée comme compagnie
d’instruction, puis d’infanterie de marche. Les deux groupes sont finalement
dissous fin août 1940.
Pourtant, ces débuts confidentiels et éphémères n’en marquèrent pas moins la véritable naissance des TAP. Dès juillet 1941, une Compagnie d’Infanterie de l’Air fut recréée en zone libre mais c’est le 1e R.C.P qui, à partir de 1943, formera la première grande unité parachutiste française. Bien que n’effectuant lui non plus aucun saut en opération, ce régiment participera activement en 1944-45, dans les Vosges et en Alsace, à la libération de la Métropole.
[Accueil] [Actualité] [Archives] [Contacts] [SERVICES]
Copyright © 2004 Vincent
Bernard tous droits réservés - haut de page